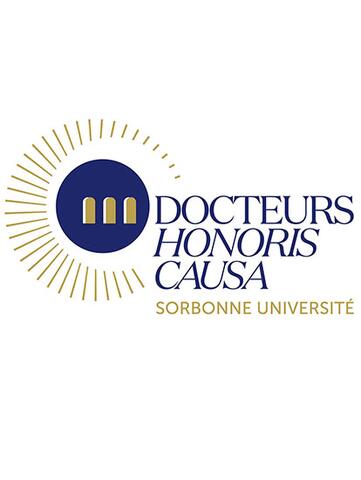
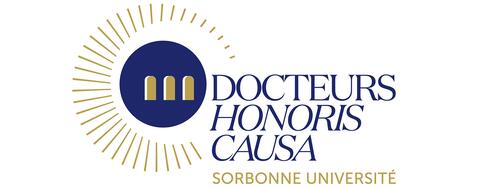
Sorbonne Université honore huit personnalités d'exception
Le 25 mars, Sorbonne Université décernera le titre de Docteur Honoris Causa à huit personnalités étrangères. Cette prestigieuse distinction, attribuée par les plus grandes universités du monde, est délivrée en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles rendues aux arts, aux lettres, aux sciences et aux techniques, apportées à la France ou à l'université. À cette occasion, les récipiendaires seront présents lors de moments d’échange sur leurs travaux respectifs.
La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube de Sorbonne Université.

Giovanna Mallucci, spécialiste des maladies neurodégénératives
Chercheuse clinicienne en neurosciences, Giovanna Mallucci est chercheuse en cheffe fondatrice d'Altos Labs de l'Institut des sciences de Cambridge. Elle est reconnue internationalement pour ses travaux innovants sur la neuro-dégénérescence et ses approches thérapeutiques de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, actuellement en phase d'essai clinique.
Née en 1963 au Royaume-Uni, c’est après des études de médecine et une spécialisation en neurologie à l’Université d’Oxford que la professeure Giovanna Mallucci a complété sa formation scientifique avec l’obtention d’un doctorat à l’Imperial College. Sous la direction du Professeur John Collinge, ses travaux de recherche lui ont permis de mener un travail remarquable sur les maladies à prions.
En 2008, elle rejoint l’unité de toxicologie du Conseil de la recherche médicale britannique puis sera nommée en 2014 professeure van Geest de neurosciences clinique à l'Université de Cambridge. Elle devient, en 2017, directrice de l'institut britannique de recherche sur la démence et a mené plusieurs équipes de chercheuses et chercheurs. Ses travaux de recherche inédits ont concouru à des avancées considérables permettant de découvrir la réversibilité de la dégénération précoce et de comprendre le rôle de la réponse UPR (unfolded protein response).
En 2017, elle a été élue à l'Académie des sciences médicales, et elle reçoit en 2021 le prix Potamkin soulignant le caractère historique et innovant de ses recherches notamment sur les maladies de Pick et d’Alzheimer.
L’excellence scientifique de ses recherches ont très largement contribué à l’identification de traitements contre la démence et les maladies dégénératives.
Tout en gardant son affiliation à l'université de Cambridge, elle rejoint l’entreprise Altos Labs, entreprise spécialisée dans la pathophysiologie du rajeunissement, en tant que chercheuse en cheffe suite à ses recherches mécanistiques et translationnelles dans les pathologies neurodégénératives.
L’excellence scientifique de ses recherches ont très largement contribué à l’identification de traitements contre la démence et les maladies dégénératives.
Animée par la passion de comprendre les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent la mort des cellules cérébrales, elle s'efforce de traduire ces découvertes en nouvelles thérapies. C’est cette passion et son engagement pour la science qui lui ont permis d’identifier deux médicaments, dont la trazodone hydrochloride aujourd’hui commercialisée comme antidépresseur, efficace dans la prévention des maladies neurodégénératives chez la souris, est actuellement testée chez l'homme.
Cette distinction honore sa liberté de ton, essentielle dans ce secteur et la voix qu’elle porte est un modèle pour de nombreuses femmes scientifiques d’aujourd’hui et de demain.

Jean-Jacques Muyembe, co-découvreur du virus Ebola
Virologue de renommée mondiale, Jean-Jacques Muyembe a été co-découvreur du virus Ebola en 1976 et a consacré sa carrière à la lutte contre les épidémies. Directeur de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa depuis 1998, il a notamment co-inventé l'anticorps monoclonal « mAb114 » contre Ebola.
Virologue mondialement reconnu, le professeur Muyembe a consacré sa carrière à la lutte contre différentes épidémies. Né en 1942 en République Démocratique du Congo (RDC), c’est de l’Université de Kinshasa qu’il sera diplômé en microbiologie en 1969. Il obtiendra un doctorat en virologie de l’Université de Louvain en 1973.
A son retour en RDC en 1974, il est amené à travailler sur l’épidémie de choléra et sur la fièvre hémorragique Ebola dont il fut l’un des codécouvreurs. En 1978, il sera nommé doyen de l’école médicale universitaire de Kinshasa, ses travaux et son engagement le conduiront à rejoindre en 1981 l’Institut Pasteur de Dakar où il travaillera en étroite collaboration avec le centre pour le contrôle et la prévention des maladies pour étudier le virus d’Ebola et de Marburg.
Nommée en 1995 coordonnateur national de la riposte contre Ebola, ses différents travaux de recherche mettront en lumière les aspects épidémiologiques de la maladie, notamment le rôle amplificateur des hôpitaux et des rites funéraires.
Ses recherches et sa connaissance du terrain feront de lui un choix évident pour assurer, dès 1998, la direction de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la RDC. L’INRB devient un centre d’excellence grâce à son leadership et à son approche novatrice dans le souci de former les jeunes générations de scientifiques. Convaincu que les crises épidémiologiques ne peuvent se résoudre sans une dynamique partenariale internationale forte, il œuvrera à faire de l’INRB un centre international pour les maladies infectieuses émergentes.
Il joue un rôle crucial dans l’authentification du point de départ du VIH à Kinshasa, d’Ebola et plus récemment, lorsqu’il fut chargé par le président Félix Thisekedi, de la lutte contre l’épidémie de Sars-Cov-2. C’est en 2020 qu’il identifie un traitement appelé « EBANGA » approuvé par la FDA américaine pour lutter contre Ebola.
Précurseur dans la mise en place de mesures de contrôle de l’épidémie, les protocoles développés par le Professeur inspireront de nombreuses politiques de santé publique occidentales lors de l’épidémie de Sars-Cov-2.
Récipiendaire de nombreuses distinctions, il fut désigné par Time l’une des 100 personnalités les plus influentes en 2020.
Convaincu que la sensibilisation des communautés et la prise en compte des coutumes locales sont des facteurs majeurs à considérer lors d’une épidémie, il est une source d’inspiration pour de nombreux scientifiques d’Afrique et du monde.

Chimamanda Ngozi Adichie, autrice d'"Americanah"
Écrivaine nigériane renommée, Chimamanda Ngozi Adichie a conquis la scène littéraire internationale avec des romans tels que "L'Hibiscus pourpre" et "Americanah". Elle est élue à l’Académie américaine des arts et des sciences en 2017.
L’œuvre de Chimamanda Ngozi Adichie, autrice nigériane d’expression anglaise, s’écrit sous nos yeux. Au travers de trois romans à ce jour (le quatrième, Dream Count, paraît en mars 2025), de nombreuses nouvelles dont certaines sont recueillies en un volume, d’une pièce de théâtre, d’un livre pour enfants, d’essais, dont Notes on Grief (2021) autour de la mort de son père, elle a façonné une réputation mondiale. Elle revendique une appartenance multiple : igbo, nigériane, africaine. Installée en partie aux États-Unis, elle connaît toutes les complexités des migrations et des diasporas. Mme Adichie défend des positions politiques fortes. Dans We Should All Be Feminists (2014) et Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions (2017), elle s’attaque aux inégalités entre femmes et hommes, ouvre des voies, invite au changement. Les femmes doivent être autrices de leur propre destinée, et cette position politique parcourt toute son œuvre romanesque.
Née en 1977, elle a grandi dans la mémoire de la guerre du Biafra, terminée sept ans plus tôt, mais dont le trauma habite sa famille. C’est le roman Half of a Yellow Sun (2006) qui en livre une impressionnante chronique. Elle sait l’histoire politique du pays, les luttes pour la démocratie dont Purple Hibiscus (2003) porte la trace. La puissance de ce combat politique est d’autant plus grande que sa présence narrative est discrète. Ce sont aussi les effets du colonialisme qu’elle dissèque, au travers des missions chrétiennes qui ont façonné les individus dans la violence et la soumission. Elle interroge la distance entre les communautés nigérianes des États-Unis et les familles restées au pays, sans oublier l’Angleterre : son troisième roman, Americanah (2013), entretient par l’écriture les liens qui subsistent, au-delà de l’espace et du temps. Elle y explore les identités qui se font et se défont, les rapports de domination, la confrontation au racisme.
Son œuvre s’inscrit dans la tradition d’une littérature nigériane en anglais, Chinua Achebe pour qui l’autrice a dit son admiration, Christopher Okigbo, mort pendant la guerre du Biafra, Wole Soyinka, prix Nobel de littérature. C’est aussi par son sens du détail, par l’évocation d’une fleur, de figurines époussetées et brisées, de cheveux tressés que Mme Adichie façonne un univers familier de livre en livre. La quête de l’universel au travers d’histoires individuelles anime son écriture, et résonne particulièrement dans les murs de la Sorbonne.

Oliver Primavesi, spécialiste d'Aristote, Prix Leibniz
Philologue de l'antiquité grecque, Oliver Primavesi occupe la chaire de professeur de philologie grecque à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich. Spécialiste de la pensée d'Aristote, il a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix Leibniz en 2007.
Oliver Primavesi, né le 17 février 1961 à Offenbach-am-Main, est depuis 2000 professeur ordinaire de philologie grecque à l’université Ludwig-Maximilian de Munich. Après un premier cursus de latin et de musique au conservatoire de Francfort, il a opté pour une carrière d’helléniste. C’est l’un des spécialistes de la langue et des textes grecs, et de la pensée antique en général, les plus renommés au plan international. Ses découvertes comme philologue de la philosophie grecque – il a reconstitué d’importants textes antiques que l’on croyait perdus et amélioré le texte de plusieurs œuvres grecques – lui ont valu de nombreux prix prestigieux, comme, le Prix Reinach de l’Association pour l’Encouragement des Études Grecques ou le prix Gottfried-Wilhelm-Leibniz.
Son œuvre interroge tous les aspects de la civilisation grecque, dans son articulation créatrice de la philosophie, des sciences, de la littérature et des arts plastiques. Depuis sa thèse sur la doctrine aristotélicienne de l’argumentation dialectique, Oliver Primavesi a étudié sans relâche l’histoire de la philosophie grecque classique. C’est un spécialiste aguerri d’Aristote, dont il est à la fois un éditeur virtuose (son édition critique de Métaphysique A et du traité Du mouvement des animaux ont fait date) et un commentateur hors-pair. Il est également l’un des maîtres actuels des études présocratiques – sa reconstitution du système d’Empédocle a été l’un des événements marquants, dans le champ de la philologie classique, de ces dernières décennies. Combinant l’édition critique de textes inédits – dont le fameux « papyrus de Strasbourg », qu’il a publié tout d’abord en collaboration avec le papyrologue belge Alain Martin, puis seul, dans plusieurs monographies – à des études d’ampleur sur la pensée physique, religieuse et éthique du philosophe d’Agrigente, Oliver Primavesi a permis un nouveau regard sur ce dernier, mais aussi sur toute la philosophie grecque du Ve siècle. À ces œuvres s’ajoutent des contributions de premier ordre, en philosophie, poésie, en histoire de l’art ainsi que sur différents aspects de la lyrique grecque.
Oliver Primavesi, enfin, est un chercheur sensible aux questions de réception du patrimoine grec, de l’Europe médiévale et renaissante à Winckelmann, jusqu’à Nietzsche et Brecht. Il est l’un des chercheurs qui ont le plus œuvré à une réflexion renouvelée sur le sens de la philologie classique et sur sa place dans le devenir de la pensée européenne.

Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Chercheur en neurosciences et premier Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion a contribué à une meilleure compréhension de maladies telles que l'Alzheimer et la dépression. Auteur de plus de 750 publications, il est l'un des neuroscientifiques les plus cités au monde.
Docteur en pharmacologie de l’Université de Sherbrook et postdoctorant au National Institute of Mental Health à Washington, Rémi Quirion est l’un des membres fondateurs de l’International Network for Government Science Advice. Nommé Scientifique en chef du Québec en 2011, son engagement indéfectible en faveur de la diplomatie scientifique et des collaborations internationales a contribué de manière significative à renforcer les liens entre la France et le Québec.
Jusqu’à sa nomination, il était vice‐doyen aux sciences de la vie et aux initiatives stratégiques de la Faculté de médecine de l’Université McGill et conseiller principal de l’Université. Il a été directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut Douglas, professeur titulaire de psychiatrie à McGill et directeur exécutif de la Stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d’Alzheimer des Instituts de recherche en santé du Canada. Ses travaux ont grandement contribué à une meilleure compréhension du rôle du système cholinergique dans la maladie d’Alzheimer, du neuropeptide Y dans la dépression et la mémoire, et du peptide relié au gène de la calcitonine dans la douleur et la tolérance aux opiacés.
À travers ses multiples fonctions, il a su favoriser des coopérations scientifiques d’envergure entre des institutions québécoises, telles que l’Université Laval, et Sorbonne Université, au bénéfice de l’innovation et de l’excellence académique dans les domaines de la santé, de l’environnement et des sciences sociales. Sous son impulsion, ces collaborations ont permis de développer des réponses novatrices aux défis globaux, de renforcer le rayonnement de la recherche francophone à l’échelle internationale et de contribuer à la formation d’une nouvelle génération de chercheuses et chercheurs.
Auteur de plus de 750 publications dans des revues scientifiques reconnues, il est l’un des chercheurs en neurosciences les plus cités dans le monde. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont l’Ordre national du Québec en 2003, l’Ordre du Canada en 2007, c’est en 2015 qu’il est promu Officier dans l’Ordre des Palmes académiques de la République française pour son apport au développement des relations franco-québécoises en matière de recherche.
Visionnaire et bâtisseur, il incarne l’idée d’une science ouverte et collaborative qui œuvre à créer des ponts entre les cultures scientifiques et académiques, tout en s’engageant à faire de la recherche un moteur de progrès partagé.

James Ferguson Skea, président du GIEC
Climatologue écossais, James Skea est le président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) depuis 2023. Ses travaux portent sur les questions d'énergie, de changements climatiques et d'innovation technologique.
Né en 1953, James Ferguson Skea est un scientifique britannique, spécialiste de l’économie des énergies renouvelables et des politiques environnementales. Diplômé d’un master en physique mathématique de l’Université d’Édimbourg en 1975, titulaire d’un doctorat de l’Université de Cambridge en recherche énergétique en 1978, il devient assistant de recherche à l’Université de Cambridge jusqu’en 1981, puis professeur adjoint invité à l’Université Carnegie-Mellon où il travaillera sur la sécurité énergétique et les politiques environnementales.
En 1983, il rejoint l’Université du Sussex où il occupera le poste de professeur puis de directeur de l’Institut des Études Politiques de 1998 à 2004. Depuis 2009, il est professeur émérite d’énergie durable au centre de politiques environnementales de la faculté des sciences naturelles de l’Imperial College de Londres et est chercheur en stratégie énergétique du Research Council UK entre 2012 et 2017.
Membre de la commission britannique sur le changement climatique de 2008 à 2018, il a également présidé de nombreuses autres commissions : le programme sur le changement environnemental mondial du conseil de recherches économiques et sociales de 1995 à 1998 ; la commission écossaise sur la transition juste de 2018 à 2023 ; l'institut britannique de l'énergie entre 2015 et 2017. Depuis 2017, il est membre éminent du conseil de recherche en ingénierie et en sciences physiques.
Tout au long de sa carrière, Jim Skea a travaillé à l'interface entre la recherche, l’environnement, l'élaboration des politiques et les entreprises. Il a co-présidé le groupe de travail 3 portant sur les mesures d’atténuation du changement climatique et a très largement contribué aux rapports spéciaux du GIEC de 2016, de 2019 et de 2022.
Cette longue expérience a fait de lui un choix particulièrement pertinent pour être élu à la nouvelle présidence du GIEC, poste qu’il occupe depuis juillet 2023. Sa présidence s’articule autour de trois priorités : améliorer l’inclusivité et la diversité, développer l’interdisciplinarité dans les sciences du climat, et renforcer la pertinence politique des rapports d’évaluation du GIEC.
Scientifique de renom et reconnu par ses pairs, il a reçu plusieurs distinctions pour honorer son engagement : Officier de l’empire britannique pour service aux transports durables en 2004, le prix Melchett de l’institut de l’énergie en 2010 et plus récemment, il a été nommé chevalier du Royaume-Uni en 2024.

Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature
Écrivaine polonaise et lauréate du prix Nobel de littérature en 2018, Olga Tokarczuk explore dans ses œuvres des thèmes qui lui sont chers : le mystère, le mythe et le voyage. Son roman Les livres de Jakob est considéré comme son chef-d'œuvre et a reçu un grand succès critique et public.
Olga Tokarczuk, une des voix littéraires les plus influentes de la Pologne contemporaine, traduite dans plus d’une cinquantaine de langues, est lauréate du Prix Nobel de littérature 2018. L’Académie suédoise a salué son « imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, représente le franchissement des limites comme une forme de vie ».
À travers ses œuvres Tokarczuk explore avec subtilité les thèmes de l’identité, de l’ouverture à l’Autre, de l’errance, de la mémoire, du temps et de la condition humaine qui invite à une lecture engagée du monde et résonne avec les grands questionnements de notre époque. Née en 1962 en Pologne, de parents enseignants, elle grandit dans une famille d’intellectuels progressistes. Elle étudie la psychologie à l’Université de Varsovie, formation qui influence profondément son écriture. Sa carrière littéraire s'affirme rapidement, avec une première publication remarquée en 1989, suivie d’une série de romans qui lui ont valu une renommée croissante.
Parmi ses œuvres majeures accessibles en français, on peut citer Dieu, le temps, les hommes et les anges (1996), Récits ultimes (2004) ou Les Pérégrins (2007), qui lui a valu le prestigieux Prix Nike en Pologne et le Man Booker International Prize, en 2018, pour sa traduction en anglais, ainsi que Sur les ossements des morts (2009) un roman qui fait écho à l’écologie, au féminisme et à la critique sociale et qui a été porté à l’écran par Agnieszka Holland dans le Tableau de chasse (2017). Son opus magnum, Les Livres de Jakób (2014) est une fresque historique monumentale et foisonnante qui raconte l’épopée d’une secte hérétique en Pologne au XVIIIe siècle, explorant des thèmes tels que la religion, la tolérance et le pouvoir. Le dernier en date à être traduit en français, Le banquet des Empouses (2022) est un dialogue savoureux avec la Montagne magique de Thomas Mann doublé d’une relecture critique d’écrits consacrés aux femmes depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle.
L’originalité de l’écriture de Tokarczuk réside dans sa capacité à mélanger les genres, à brouiller les frontières entre réalité et fiction, et à créer des récits fragmentés qui reflètent la complexité du monde contemporain et invitent à la réflexion sur ses enjeux les plus cruciaux dans un style à la fois poétique et philosophique. Son œuvre cherche obstinément à redonner vie à la diversité refoulée qui compose la nation polonaise. Son prix Nobel est venu récompenser ce refus de l’homogène.

Maryna Viazovska, médaille Fields
Mathématicienne ukrainienne, Maryna Viazovska a reçu la prestigieuse médaille Fields en 2022. Ses travaux sur les empilements de sphères ont été largement reconnus, la propulsant comme l'une des mathématiciennes les plus influentes de notre époque.
Née à Kiev en 1984, c’est à l’âge de 12 ans que Maryna Viazovska se découvre une passion pour les mathématiques et la physique. Aujourd’hui mathématicienne mondialement reconnue pour ses découvertes fondamentales en théorie des nombres et en analyse harmonique, elle est professeure et titulaire de la Chaire d’arithmétique à l’EPFL de Lausanne. Ses percées sur la résolution du problème d’empilement de sphères ont été récompensées en 2022 par la médaille Fields, faisant d’elle la deuxième femme à obtenir cette distinction.
Le problème d’empilement de sphères consiste à trouver la manière d’empiler des sphères dans un espace à n dimensions en laissant le moins de vide possible. Avant ses travaux, la réponse n’était connue qu’en dimensions 2 et 3. En 2016, encore chercheuse postdoctorale à l’Université Humboldt de Berlin, Maryna Viazovska démontre que l’empilement optimal en dimension 8 s'obtient en plaçant les centres des sphères sur un réseau très symétrique que les mathématiciens connaissaient depuis longtemps sous le nom de E8. Une semaine après, avec ses collègues Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen Miller et Danylo Radchenko, elle parvient à identifier l’empilement optimal en dimension 24, celui donné par le réseau de Leech, une structure mystérieuse découverte en 1967 qui possède des liens avec la théorie des cordes et le plus grand groupe fini sporadique, appelé « le monstre ».
Les travaux extraordinaires de Maryna Viazovska reposent sur une technique d’optimisation linéaire introduite par Henry Cohn et Noam Elkies en 2003. Elle eut la brillante idée d'exploiter des outils qui avaient été jusque-là complètement étrangers au problème : des fonctions quasi-modulaires, qu’elle avait déjà étudiées lors de sa thèse de doctorat obtenu à l’Université de Bonn en 2013 sous la direction de Don Zagier et Werner Müller. On les appelle désormais « les fonctions magiques de Viazovska ».
Après cette découverte révolutionnaire, ses méthodes mathématiques, à la fois algébriques, combinatoires, arithmétiques et analytiques, n’ont cessé de se diffuser à d'autres domaines et d'autres dimensions faisant le régal de toutes les mathématiciennes et tous les mathématiciens du monde entier.
Récompensée par de nombreux prix tels que le New Horizons in Mathematics Prize en 2018 ou encore le prix de la société européenne de mathématique en 2020, la professeure Maryna Viazovska est une source d’inspiration incontestable pour les femmes scientifiques d’aujourd’hui et de demain.

