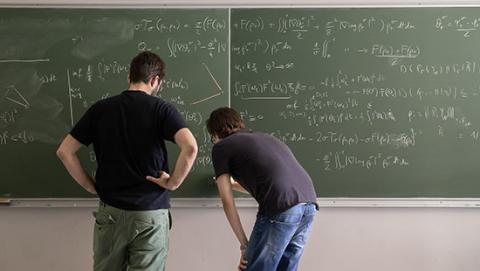2e appel à projets doctoraux et post-doctoraux SOUND
Le projet SOUND a lancé son 2e appel à projets doctoraux et postdoctoraux pour sélectionner et financer 12 projets scientifiques pluridisciplinaires à impact social autour de ses 3 programmes thématiques. L’appel à candidatures sur ces projets est désormais ouvert, jusqu’au 5 mai.
Une recherche pluridisciplinaire, engagée avec et pour la société
Le volet « recherche » du projet SOUND repose principalement sur le financement de contrats doctoraux, complétés par des missions doctorales en médiation scientifique, et de contrats post-doctoraux.
Pour cette campagne 2025-2028, 12 projets scientifiques pluridisciplinaires à impact social, assortis d’actions citoyennes, culturelles, de communication, seront financés.
- Pour soumettre votre candidature, renseignez le formulaire selon votre projet :
- Projets de recherche doctorale
- Projets de recherche post-doctorale - Téléchargez le détail de l'appel à projets
- Découvrez les projets de la première campagne 2024
- Informations par courriel auprès du projet SOUND
Consultez les projets doctoraux ouverts à candidature
Consultez les projets post-doctoraux ouverts à candidature
- « Quelle recherche de provenance pour les collections naturalistes ? Étude comparative des collections des soeurs Colani (Muséum national d’Histoire naturelle, Musée de l’Homme, Musée du Quai Branly) » proposé par Serge Reubi, Centre Alexandre Koyré (CAK), MNHN UMR 8560 – coportage avec Amandine Péquignot, laboratoire Patrimoines locaux, Environnement et Globalisation (PALOC) MNHN UMR 208. Voir le détail du projet. Contact : Serge Reubi.
- « Recherche-action « Ethnographier, collecter, raconter : lutter contre l’amnésie environnementale ? » proposé par Mélodie Faury, laboratoire PALOC « Patrimoines locaux, environnement et globalisation » MNHN UMR 208 – coportage avec Joëlle Le Marec, laboratoire PALOC « Patrimoines locaux, environnement et globalisation » UMR 208 MNHN. Voir le détail du projet. Contact : Mélodie Faury.
- « Comment transmettre au grand public les éléments scientifiques, méthodologiques et dramaturgiques d'un spectacle théâtral historiquement informé ? » proposé par Andrea Fabiano, Équipe Littérature et Culture Italiennes, Sorbonne Université, UR 1496. Voir le détail du projet. Contact : Andrea Fabiano.
- « Des collectifs transocéaniques émergents à l’ère de l’Anthropocène. Comprendre et valoriser l’apport des arts et littératures Arctique et Indo-Pacifique dans la gouvernance des océans » proposé par Sylvain Briens, laboratoire REIGENN, EA 3556, Sorbonne Université – en coportage avec Hélène Artaud, laboratoire PALOC, UMR 208, MNHN. Voir le détail du projet. Contact : Sylvain Briens.
- « Defining neighborhood walkability and the association with children's development and mental health » proposé par Maria Melchior, IPLESP - Substance Use (ESSMA) UMR_S 1136, Sorbonne Université / Inserm. Voir le détail du projet. Contact : Maria Melchior.
- « Exposition prénatale à des hydrocarbures aromatiques polycycliques (hap4) et conséquences pour la cancérogenèse à long terme », proposé par Latifa Najar, laboratoire Biologie, Vaisseaux et Thérapeutiques du Cancer, UMR S 938, Sorbonne Université. Voir le détail du projet. Contact : Latifa Najar.
- « Modelling sensorimotor learning during balance rehabilitation after an ankle injury » proposé par Ludovic Saint-Bauzel, Institut des Systèmes Intelligents et Robotique, UMR 7222 Sorbonne Université. Voir le détail du projet. Contact : Ludovic Saint-Bauzel.
- « Economic policies for neglected and drug-resistant diseases in a context of climate change: a health equity and Global South perspective » proposé par David Flacher, laboratoire COSTECH, UTC. Voir le détail du projet. Contact : David Flacher.
- « Exposition aux micropolluants dans l'alimentation, Bio-accessibilité et métabolisations » proposé par Franck Merlier, laboratoire Génie enzymatique et cellulaire UMR7025. Voir le détail du projet. Contact : Franck Merlier.
- « Classifications et savoirs expérientiels en santé mentale » proposé par Xavier Guchet, laboratoire COSTECH, UTC, UR 2223. Voir le détail du projet. Contact : Xavier Guchet.
- « Impact of global changes on soil microbial diversity: a historical DNA (hDNA) approach » proposé par Roland Marmeisse, Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité, MNHN, UMR7205. Voir le détail du projet. Contact : Roland Marmeisse.
- « Métabolisme microbien de lacs urbains : puits ou source de carbone et d’azote sous stress anthropique ? » proposé par Julie Leloup, Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris – IEES, Sorbonne Université UMR 7618. Voir le détail du projet. Contact : Julie Leloup.
- « AVRI – Adapter les villes aux inondations par la résilience : action, médiation, participation » proposé par Anna Geppert, laboratoire Médiations – Sciences des lieux, sciences des liens, Sorbonne Université. Voir le détail du projet. Contact : Anna Geppert.
- « Écologie thermique au service de la conservation : prise en compte des microclimats dans l’analyse des risques et l’évaluation des solutions » proposé par Jean-François Le Galliard, laboratoire iEES Paris, Sorbonne Université, UMR 7618. Voir le détail du projet. Contact : Jean-François Le Galliard.
- « Display » proposé par Ariel Lindner, laboratoire Computational, Quantitarive, and Synthetic Biology (CQSB), Sorbonne Université, unité 7238 – coportage avec Romain Julliard, laboratoire CESCO, MNHN. Voir le détail du projet. Contact : Ariel Lindner.
- « Appropriation de la gestion durable des eaux urbaines par les projets urbains. Analyse à partir des quartiers Ginko (Bordeaux), Tasta (Bruges) et Rive de la Haute Deûle (Lille) » proposé par Patrizia Ingallina, laboratoire MEDIATION, U.R. Sorbonne Université – coportage avec Nassima Voyneau, laboratoire AVENUES, UTC. Voir le détail du projet. Contact : Patrizia Ingallina.
- « Living Lab STELLA : exploration des modes durables de recharge des véhicules électriques en impliquant activement les utilisateurs et en appliquant des méthodes participatives pour proposer des solutions concrètes d’amélioration des stratégies de recharge et de changement de comportement » proposé par Manuela Sechilariu, laboratoire AVENUES, UTC. Voir le détail du projet. Contact : Manuela Sechilariu.
- « Projet de recherche pour une facture instrumentale et des savoir-faire durables » proposé par Benoît Fabre, Institut Jean Le Rond d'Alembert Sorbonne Université, UMR7190. Voir le détail du projet. Contact : Benoît Fabre.
- « Rôle du changement climatique sur la déstabilisation des hydrates de méthane, et sur le déclenchement des glissements de terrain sous-marins à potentiel tsunamigénique » proposé par Sara Lafuerza, Institut des Sciences de la Terre de Paris, Sorbonne Université UMR7193 – coportage avec Nina Aguillon, laboratoire Jacques Louis Lions, Sorbonne Université UMR 7598. Voir le détail du projet. Contact : Sara Lafuerza.
Les caractéristiques de l’appel à projets doctoraux et post-doctoraux de SOUND
- La connexion forte à l’une ou plusieurs des priorités thématiques identifiées au sein de chaque programme thématique.
- L'approche pluri- et/ou inter-disciplinaire, voire inter-sectorielle, pour répondre aux enjeux sociétaux en lien avec un partenaire externe (existant ou à identifier).
- L’ancrage des projets soutenus dans la société civile sous différentes formes : partenariat formel avec une organisation publique ou privée, méthodes participatives dans la collecte et le traitement des données.
- Actions de médiation et/ou d’expertise anticipées dans la conception même du projet, ouverture des données et des résultats attendus, contribution explicite à des questions de débat public.
- L’approche soutenable : les candidates et candidats sont incités à entamer des réflexions autour de l’impact environnemental de leur projet lors de sa rédaction et invités à établir un plan d’action lors de la signature de contrat, avec l’aide de l’équipe SOUND.
- Les co-directions ou co-supervisions seront issues de deux disciplines différentes, selon les possibilités.
Dans le cas d’une thèse en co-direction, au moins un ou une des deux co-directeurs ou co-directrices doit être titulaire de l’HDR ou équivalent, et être affectés à deux unités de recherche et écoles doctorales sous tutelle de l’un des établissements de l’Alliance Sorbonne Université.
Priorités scientifiques de l'appel à projets
Comment les sociétés parviennent-elles à répondre aux grands changements passés et en cours ? En quoi la réponse des groupes sociaux de différentes époques et de différents lieux éclaire-t-elle nos perspectives futures ? Comment les mutations créent-elles des brèches, des menaces, et des opportunités sociales, technologiques, économiques ou culturelles pour l’ensemble de la société ?
Le programme « Sociétés en mutation » a pour ambition d’explorer ces questions, en définissant trois thèmes prioritaires :
- le champ des inégalités (sociales, politiques, ethniques, de genre, climatiques, sanitaires, générationnelles, technologiques, etc.) ;
- la crédibilité de l'information et le rapport à la vérité scientifique (dans le langage, les images, à travers le développement du numérique, etc.) ;
- la gestion et la transmission des héritages académiques (patrimoine, résonance des savoirs, etc.)
Axe 1 – Inégalités
Les inégalités – sociales, politiques, ethniques, de genre, climatiques, sanitaires, générationnelles, technologiques, etc. – sont un enjeu majeur de nos sociétés. Leur analyse suscite une prise de conscience accrue de leur diversité et de leur ampleur. L’objet de ce premier axe est d’étudier les inégalités à différentes échelles – chronologique, géographique –, et selon différents points de vue – sociologique, politique, historique, philosophique. L’enjeu est de les mettre en perspective pour réfléchir à des réponses théoriques et/ou pratiques, y compris dans une démarche expérimentale, pour les réduire. Cette question, à forte résonance sociale, doit être abordée selon une approche croisée, en favorisant le dialogue entre les disciplines.
Axe 2 – Vérité(s)
Les sociétés contemporaines ont vu croître de manière exponentielle le nombre de canaux de diffusion de l’information, et avec eux, la « démocratisation » de la parole – via l’émergence notamment des réseaux sociaux. Face à cette circulation massive d’avis et informations plurielles et parfois contradictoires, face à la possibilité des manipulations dans la CMO – communication médiée par ordinateur –, la question de la confiance se pose de manière renouvelée pour toutes les formes de discours, qu’ils soient scientifiques, politiques ou médiatiques. L’objet de ce deuxième axe est d’analyser, à toutes les époques et selon des approches croisées, la production, la réception, les usages et l’évolution des langages, des discours et des représentations. Cet objet peut se décliner en sous-questions, parmi lesquelles : le statut de la parole d’autorité ; la caractérisation de ce nouveau type de communication multi-modal ; l’émergence et la diffusion de formes inédites de discours ou d’images et leur réception, en synchronie ou dans la diachronie.
Axe 3 – Héritages
Les communautés académiques et culturelles élaborent leur savoir en assimilant, en ajustant ou en rejetant les legs du passé. Ce troisième axe souhaite interroger ce type d'héritage propre aux univers du savoir (recherche, éducation, médiation…) et de la culture (arts, langues...). Les questions pourront être abordées sous l'angle théorique et méthodologique : comment conçoit-on l'acquisition et la diffusion du savoir ? Quelles sont les formes de transmission passées et présentes permettant une nouvelle appropriation des connaissances ? Quels en sont les enjeux éthiques et juridiques ? On pourra explorer les aspects épistémologiques pour réfléchir aux modalités de construction des savoirs et proposer de nouvelles formes de transmission, dans une démarche expérimentale.
Les pistes prioritaires évoquées pour les trois thèmes sont avant tout des suggestions et n’interdisent pas d’autres propositions, dès lors qu’elles s’inscrivent dans la philosophie générale de SOUND, dans les thématiques identifiées et dans une démarche d’ouverture vers la société.
Il s’agit de développer, dans une perspective qui intègre l’exigence de partage des savoirs au service de la société, une approche globale ou holistique de la santé en mobilisant les compétences de l'ASU, avec pour objectif de susciter des impacts significatifs tant sur la santé individuelle que sur les dynamiques sociales dans une perspective de durabilité. Pour cette première phase, deux priorités ont été définies.
- L’étude de l'exposome : la notion d’exposome désigne l'ensemble des expositions environnementales auxquelles un individu est soumis tout au long de sa vie. Les substances chimiques, les agents biologiques, les radiations, les conditions de vie, les habitudes alimentaires, les interactions sociales, etc. Il s’agira de rendre compte des effets au sens large sur la santé des populations de ces différentes formes d’expositions environnementales.
- L’étude de la nutrition : un autre axe prioritaire concerne la nutrition, tant dans son incidence directe sur la santé que dans son reflet au sein des modes de vie et des cultures, ainsi que son impact environnemental, avec une attention particulière portée sur ses conséquences sur la santé globale des populations.
Il est important de souligner que ces deux priorités ne sont pas exclusives. Le programme thématique accordera également une attention particulière au développement de projets abordant les enjeux des populations vulnérables et mettant en avant une approche qui articule des dimensions biologiques, psychologiques et sociologiques. Les projets pourront enfin ne pas se limiter à une vision nationale, mais inclure des partenaires étrangers pour accroître la mise en perspective globalisée des questions traitées.
Comment les sociétés peuvent-elles concilier leurs besoins immédiats avec la préservation des ressources de la planète ? Comment mesurer précisément l’impact des activités humaines sur les écosystèmes et les systèmes planétaires, et quelles pistes suivre pour engager une transition vers des modes de vie durables ? En quoi l’adaptation des territoires aux aléas climatiques, la participation citoyenne et l’intégration de solutions fondées sur la nature offrent-elles de nouvelles perspectives ?
Le programme « Mondes durables » se propose d’explorer ces interrogations en les structurant autour de trois axes prioritaires :
Axe 1 : Anthropocène
Le premier axe, « Anthropocène », s’intéresse à la quantification, la compréhension et la réduction des impacts des activités humaines sur les écosystèmes et les systèmes planétaires. Il met l’accent sur le développement d’outils et de modèles pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre, la pollution et la perte de biodiversité, ainsi que sur l’étude de technologies et de processus industriels pour réduire l’utilisation de ressources non renouvelables. Il inclut également l’analyse des leviers sociaux, économiques et culturels susceptibles d’encourager des comportements plus durables, dans une perspective résolument interdisciplinaire (sciences de l’environnement, de l’ingénieur, de la donnée et sciences sociales) et participative (living labs). Les retombées attendues reposent tout à la fois sur des examens critiques des chemins effectifs et possibles pour réduire ces impacts, et/ou sur l’adoption d’indicateurs fiables et de solutions opérationnelles visant à atteindre la neutralité carbone.
Axe 2 : Adaptation
Le deuxième axe, « Adaptation », met l’accent sur la conception de stratégies résilientes pour faire face aux changements climatiques. Il explore l’adaptation urbaine et territoriale (infrastructures résilientes, politiques adaptées aux inondations, canicules, montée des eaux) et la transition des systèmes agricoles et alimentaires (agroécologie, réduction des intrants fossiles). Il implique une approche intégrant climatologie, géographie, ingénierie et écologie, sciences humaines et sociales, pour évaluer les enjeux, les freins et les leviers disponibles. L’objectif est de proposer des réponses locales et régionales améliorant la résilience des communautés, tout en favorisant l’intégration de ces avancées dans les politiques publiques.
Axe 3 : Solutions fondées sur la nature
Le troisième axe, « Solutions fondées sur la nature (SFN) », se consacre à l’utilisation des écosystèmes pour répondre aux défis climatiques et environnementaux. Il se concentre sur la restauration de milieux dégradés (zones humides, forêts, sols), la création de villes vivantes (végétalisation, micro-forêts, corridors écologiques) et la mise en valeur des services écosystémiques (régulation climatique, gestion de l’eau), notamment par le recours au biomimétisme. Cette approche nécessite de combiner écologie, urbanisme, ingénierie et sciences humaines et sociales, en partenariat avec des ONG, des collectivités locales et des acteurs privés. Les retombées escomptées concernent la création de démonstrateurs et l’intégration des services écosystémiques dans la planification urbaine et la gestion des territoires. Les axes prioritaires pour ces thèmes servent de guide et ne limitent en rien la créativité des propositions, pourvu qu'elles restent fidèles à l'esprit de SOUND, qu'elles se rapportent aux thématiques définies.
Calendrier et modalités
Le calendrier de cet appel 2025 est commun avec l’ensemble des programmes doctoraux pilotés par le Collège doctoral :
- 20 janvier – 26 février : appel à projets
Les porteurs et porteuses de projet (directeurs et directrices de doctorat ou post-doctorat) déposent leurs projets sur le site dédié à cet effet. Les projets de recherche peuvent proposer le recrutement de doctorantes, doctorants, post-doctorantes et post-doctorants voire pour ceux qui le justifient la combinaison de ces deux recrutements.
- 26 février au 26 mars : sélection de projets
- 26 mars : publication des projets sélectionnés
Les projets sélectionnés par ces comités sont publiés sur les sites de Sorbonne Université et de ses partenaires sous la forme d’un appel à candidatures ouvert aux étudiantes et étudiants de l’ASU ou issus d’autres établissements en France et à l’étranger et, pour les post-doctorats, aux jeunes chercheuses et chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 3 ans au moment de leur candidature.
- 26 mars au 5 mai : lancement de l'appel à candidatures
Les candidates et candidats doivent prendre contact avec les porteurs et porteuses de projets avant de déposer le dossier de candidature sur le site dédié à cet effet. Les pilotes scientifiques des 3 programmes thématiques constituent des comités de sélection et organisent les auditions. L’adossement à la thèse d’une mission doctorale de médiation est obligatoire dans le cadre des contrats doctoraux, et une activité de médiation scientifique (avec formation) ou d’expertise est fortement encouragée dans celui des contrats post-doctoraux.
- 5 mai : date limite de soumission des candidatures
- 12 mai au 2 juin: audition des candidates et candidats
- 4 juin : publication des résultats